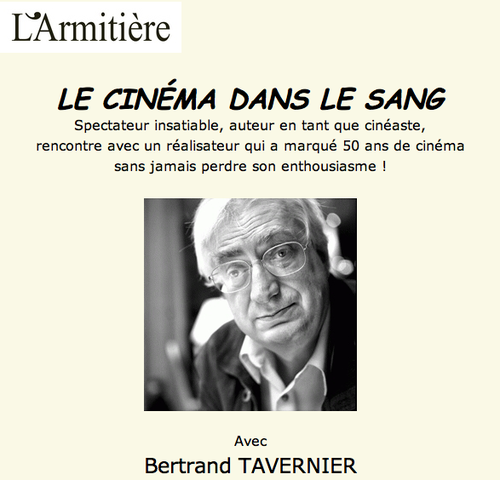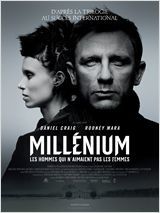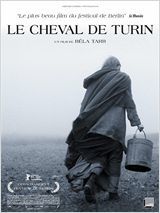Il y a des films qui semblent aller de soi pour que tout le monde les aime. En sortant de la projection d'Une bouteille à la mer, j'ai pensé que ce film en faisait partie, Erreur hélas ou.. tant mieux !?... le film de Thierry Binisti a eu un accueil controversé par la critique. C'est après avoir entendu une mauvaise critique sur France Inter et lu une autre mauvaise dans le journal Le Monde que je me suis décidé à monter au créneau pour le défendre. Le sujet est sensible car sur fond de conflit israêlo-palestinien...donc les avis ne peuvent être neutres, le film ne l'est pas d'ailleurs, mais trouve un équilibre tout en finesse dans ce monde de brutes.
Personnellement ce film m'a fait voir comment deux êtres que 73 kms (Gaza de Jérusalem) séparent peuvent se méconnaître, puis en se connaissant mieux commencer à s'aimer. On n'oublie jamais le contexte : Palestine - prison à ciel ouvert, violence extrême contre des innocents, et côté israeliens la peur d'attentats aveugles, réplique terrible à l'humiliation permanente.
Mais le film parle d'une volonté terrible de comprendre avec comme corollaire l'amour, et il nous aide très bien à le faire.
Allez voir ce film émouvant, vivant, si bien réussi à partir d'un échange de lettres, il nous aide à grandir.
Serge Diaz
" Une bouteille à la mer " aborde un sujet déjà vu au cinéma : le conflit israélo-palestinien. "Jaffa" en est l'exemple le plus récent. J'avais peur de revoir un Roméo et Juliette israélo-palestinien...Non, ce film est une très bonne surprise. Ces deux jeunes sont comme ces deux terres: perdus, pleins d'incompréhension, ils se cherchent et se déchirent mais recherchent le calme dans leur coeur. Leur longue relation épistolaire, qui reste secrète par peur de représailles, élargit leur horizon culturel et leur curiosité pour oublier le danger quotidien. Lui, Naim apprend le français (émeut sa mère en plein désarroi avec un poème de Prévert) et s'évade au sens propre comme au figuré. Le tout est traité avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité puisque j'en suis ressortie la gorge serrée
Béatrice le Toulouse